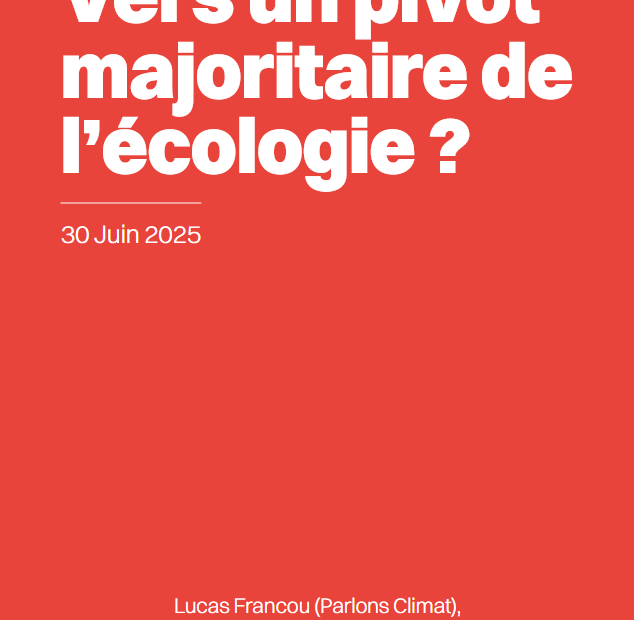Les think tanks Parlons Climat et IDDRI ont récemment publié une petite note joliment intitulée « Vers un pivot majoritaire de l’écologie? ». Connaissant la qualité du travail des auteur·e·s, je m’y suis plongé et j’en ai tiré quelques leçons pour ce qui concerne la transformation de notre système de transports.
Ce que dit la note
La note vient mettre en question l’idée répandue d’un prétendu backlash écologique. Elle met en garde contre cette notion qui peut être performative (l’évoquer est susceptible de le faire advenir). En ce qui concerne notre sujet, leur analyse vient aussi questionner l’idée même de bikelash, à savoir de possible retour de baton après des années de progrès dans notre combat pour rendre les territoires moins hostiles à la pratique du vélo. Dans mon bouquin, j’évoque l’hypothèse du bikelash, mais je l’aborde d’abord comme signe ou signal d’un système en crise et qui se défend, sans savoir si c’est une réalité matérielle.
L’analyse de Parlons Climat et l’IDDRI consiste à dire que nous avons atteint un « plateau » dans la prise de conscience des problématiques environnementales. Leur raisonnement est le suivant : depuis ses débuts, la posture du mouvement écologiste a été celle d’une « influence minoritaire », c’est-à-dire un groupe minoritaire qui élargit ses bases par un ensemble d’actions visant à populariser leurs idées, initialement ignorées, potentiellement conspuées, jusqu’au stade de normalisation/institutionnalisation. Cela se transpose pour le mouvement pro-vélo. Cette stratégie s’est avérée réussie : les thématiques portées par les écologistes, mais donc aussi par les pro-vélos, se sont imposées dans le débat public. Là où nous atteignons un plateau, c’est qu’initialement mises à l’agenda par une minorité minoritaire, les questions d’écologie (climat, biodiversité, etc.) ont atteint un seuil qui invite ceux qui s’y opposent à s’organiser plus frontalement. Ainsi, ça n’est pas tant un backlash que l’arrivée à une nouvelle ligne de front où la cause ne progresse plus. La note pointe par ailleurs qu’en grossissant, l’écologie a fini par constituer une bulle de personnes mobilisées qui sont suffisamment nombreuses pour se regarder les unes les autres, mais aussi que l’écologie est devenu un ensemble de pratique relevant de la distinction sociale. Logiquement, des groupes sociaux se distinguent de ces pratiques écologiques de distinction par le rejet. Par ailleurs, la manière dont se sont institutionnalisées les questions d’écologie pose question au regard des conditions matérielles d’existences d’une part considérable de nos concitoyens, pris dans un faisceau d’injonctions contradictoires, ou même simplement de récits sur la vie bonne contradictoires.
Ce que ça veut dire pour le vélo
L’analyse proposée par Parlons Climat ne me semble pas fondamentalement contredire mon analyse dans La Bataille du Vélo, mais offre plutôt une grille de lecture parallèle qui m’invite donc à reformuler quelques propositions à destination des critiques du système automobile.
Sur le plan de la transition mobilitaire, je formule l’hypothèse que nous n’atteindrons pas beaucoup mieux rapidement en termes de normalisation du vélo comme solution de mobilité que ce que nous avons atteint ces toutes dernières années. La lente progression de l’usage s’est considérablement accéléré avec l’effet Covid, et globalement, la pratique du vélo comme mode de déplacement s’est fortement normalisée dans des groupes sociaux spécifiques, concentrés dans les métropoles. La cyclabilité est devenu un sujet électoralement solvable à bien des endroits (géographiques ou politique), du PCF de la petite couronne à la droite Pécresse en passant par les municipalités centristes de villes moyennes qui participent au concours d’attractivité. Les véritables oppositions qui persistent vis à vis du vélo sont de trois ordres :
- la simple inertie sociale et cognitive : le shift idéologique est mûr (on aimerait que l’espace public soit moins un tuyau à véhicules) mais que ça ne suit pas ou peu par la simple incapacité à le faire (réflexes politiques de frilosité sur le stationnement, incompétences des équipes techniques, coups partis sur le mandat, budgets atones ou impilotables…)
- les intérêts antagonistes organisés : la transition mobilitaire est parfois le lieu d’affrontement entre intérêts contradictoires, intérêt général (et des déjà-à-vélo) versus intérêt de personnes motorisées privilégiées et organisées, ou versus intérêt capitalistique.
- ces intérêts sont les plus susceptibles d’être producteurs de récits et de mobilisations pour défendre le statu quo – des défenses idéologiques du tout-automobile, ou ses plus rusés avatars de limiter les excès pour sauver le bébé en sacrifiant l’eau du bain.
- les intérêts des groupes sociaux dont les conditions matériels d’existence sont telles que le maintien du statu quo représente une condition de survie sociale, quand bien même elles sont déjà en grande vulnérabilité (propriétaires en grande périphérie, titulaires d’emplois liés aux intérêts capitalistiques, etc.)
(Ces deux dernières modalités peuvent être les instruments d’un récit mobilisateur de l’extrême-droite, qui a fait le choix rationnel de s’appuyer sur les publics touchés par ces intérêts, contre la sociologie encline à la transition mobilitaire, faisant l’hypothèse a priori valide que celle-ci est plus progressiste, relativement dominante dans l’ordre social (sans l’être vraiment, sinon l’extrême-droite ne disposerait pas d’autant de soutiens financiers…), etc. Mais je ferme la parenthèse)
Ainsi, il nous reste des marges de manœuvre, mais il faut accepter que nous faisons face à des véritables intérêts contradictoires et que la progression à venir sera sans doute plus lente, car faisant face à des intérêts plus immédiatement contradictoires avec la transition mobilitaire.
Si cette hypothèse est valide, cela dessine quelques pistes de travail pour l’avenir.
1 – Consolider nos positions
Les élections municipales arrivent, et avec elles de belles opportunités de transformer une aspiration partagée en réalité politique. Cela dit, l’inverse est également possible. D’où l’intérêt de tout faire pour essayer de positionner le vélo « au-delà » des clivages politiques, ce que nous avons parfois mieux réussi à faire que d’autres mouvements. En fonction des territoires, il faut savoir ne pas trop en demander pour préserver des conquis du mandat en cours. L’infrastructure installera l’usage dans la durée, et avec les usages, la fin de la remise en cause. Dans leur note, Parlons Climat utilise la formule (matérialiste) « quand on peut, on veut » (dans cet ordre). Il s’agit de permettre au maximum pour consolider le vouloir, avant d’espérer que beaucoup plus d’entre nous « veulent ».
2 – Diversifier les émetteurs et les récits mobilisants
A la fois pour consolider nos positions et éventuellement obtenir de nouvelles victoires concrètes, le mouvement pro-vélo doit réussir à diversifier ses incarnations. Sur le plan du genre, nous avons fait des progrès considérables. Mais nous devons également nous interroger sur l’image que nous renvoyons auprès d’une grande diversité de groupes sociaux. Il y a évidemment la question des personnes racisées et/ou incarnant les quartiers populaires. Mais il y aussi les groupes sociaux plus dominant allergiques aux marqueurs de l’écologie politique ou de la gauche culturelle. La FUB a incarné la promotion pro-vélo bourgeoise ou technicienne, ce qui a ses avantages. Il y aussi d’autres groupes sociaux pour qui les questions de débrouille, d’autonomie, d’effort, peuvent être des valeurs déclencheurs1. Ce travail est déjà particulièrement avancé dans le monde anglo-saxon2.
3 – Forker le mouvement
Pour réussir le 1 (et partiellement le 2), il faut accepter que nos associations ne peuvent pas tout porter en même temps, et c’est donc ok que certaines et certains aillent porter la stratégie de l’influence minoritaire depuis un autre endroit. Ce « pôle prophétique » a une vraie utilité. Si nous sommes effectivement en fin de cycle sur la normalisation des idées défendues par le mouvement pro-vélo, il y a de l’espace pour un nouveau cycle (que les assos pro-vélo portaient parfois lorsqu’elles étaient groupusculaire) qui cette fois-ci s’attaque plus directement à l’automobile et son monde, l’aménagement du territoire, la technique. C’est d’ailleurs ce qu’incarnent un certain nombre de structures variées, le Forum Vies Mobiles ou, dans un genre qui assume la conflictualité, la Déroute des routes.
Je plaide pour une complémentarité des tactiques, mais je pense aussi qu’il devient désormais utile de disposer d’outils militants qui articulent mieux les pratiques de transports avec le reste des conditions matérielles d’existence : logement, emploi, territoires.
- Lire par exemple les travaux de Fanny Hugues https://basta.media/reparer-un-moteur-faire-des-semis-coudre-un-vetement-eloge-debrouilles-rurales-bricoler-entraide ↩︎
- Pour ce que je connais le mieux, la London Cycling Campaign y travaille activement https://lcc.org.uk/diversity-inclusion/ ↩︎